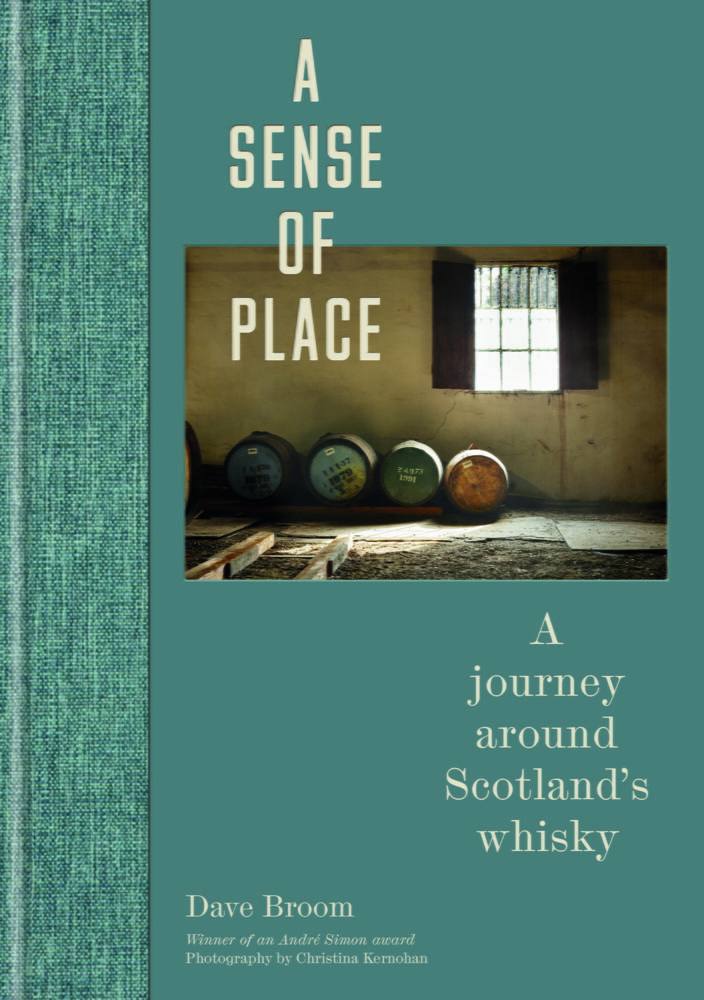L'ascension, la chute et la renaissance de l'un des single malts les plus rares d'Écosse
|
|
Temps de lecture 12 min
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
|
|
Temps de lecture 12 min
Pendant une grande partie du XXe siècle, la distillerie de Brora , comme toutes les autres en Écosse, était dédiée aux assemblages. Dans les années 1960, son équipement victorien grinçait et, en 1968, face à l'essor des assemblages en Amérique du Nord, elle fut remplacée par un modèle plus jeune et plus élégant, construit un peu plus haut sur la colline. On peut parler de la crise de la quarantaine pour le scotch. La nouvelle distillerie prit même le nom de l'ancienne : Clynelish .
Presque immédiatement, cependant, la sécheresse sur Islay ramena la vieille distillerie à la production, car les assembleurs avaient besoin d'un substitut rapide pour produire un alcool fortement tourbé. Pour éviter toute confusion, elle fut rebaptisée Brora. Puis, en 1983, face à l'effondrement de la demande de scotch, elle fut à nouveau abandonnée, comme beaucoup d'autres petites distilleries traditionnelles. Sa paisible existence était terminée. Fermée, ses entrailles cannibalisées, Brora resta silencieuse.
En 2000, cependant, un culte s'était formé autour de Brora. Peut-être parce que, comme d'autres sites tenus secrets comme Ardbeg et Port Ellen , il était enfumé, et donc en phase avec les goûts de la nouvelle vague d'amateurs de malt. Ce sont eux, au premier rang desquels l'écrivain français Serge Valentin, qui ont préservé la réputation de Brora, laissant espérer sa réouverture.
Peut-être que le fait qu'elle soit restée une entité physique a permis de se poser la question : « Et si ? » Peut-être est-ce allé encore plus loin. Se pourrait-il que le caractère étranger de la distillerie Brora corresponde à la personnalité d'un certain type d'amateur de whisky iconoclaste ?
Laissez-moi vous expliquer ce qu'est un « outsider ». Les distilleries les plus célèbres du monde se conforment à un idéal de beauté. Elles sont posées, racées, élégantes. Le whisky Brora est huileux, cireux et oxydatif. Il ne suit pas les mêmes règles, et c'est cette proximité avec l'orthodoxie qui le rend fascinant.
Mais il disparaissait, gorgée après gorgée. Puis, en 2017, la nouvelle de sa résurrection est tombée, et c'est pourquoi nous nous tenons sous une pluie diluvienne devant ses nouvelles portes, à la rencontre du tout nouveau présentateur local, Andy Flatt, et de son manager, Stewart Bowman (qui a depuis quitté le club pour devenir manager d'Arran). Tous deux sont parfaitement coiffés. La longue barbe de Stewart est nouée, celle d'Andy est impeccablement peignée. Ce n'est pas la première fois que je me sens mal habillée et négligée.
À chaque fois que j'allais à Clynelish, je me faufilais jusqu'au site en ruine, avec ses murs effondrés et ses pierres couvertes de mousse, scrutant les alambics à travers des fenêtres crasseuses et m'interrogeant. Maintenant, ses murs de calcaire pâle luisent, le gravier est ratissé, les lumières sont allumées, la cloche de la distillerie sonne à nouveau.
La raison pour laquelle les images ont été conservées n'avait rien à voir avec des plans secrets. « Sans elles, le bâtiment se serait effondré », explique Stewart. « Pour les extraire, il aurait fallu soit les découper, soit arracher le toit, auquel cas le bâtiment se serait effondré. » Le bâtiment a été démonté pierre par pierre, les fondations creusées, une nouvelle charpente métallique posée, puis reconstruit. C'est une prouesse remarquable.
Le père de Stewart fut le dernier agent des douanes de Sutherland. D'après Stewart, un vieux registre de production hebdomadaire que son père avait consigné dans les archives du grenier indiquait que « la distillerie Brora fermait ses portes pour une période de silence indéterminée en mars 1983 ». Le 5 mars 2021, Stewart reprit la production.
Nous avons été rejoints par Kevin Innes, qui a commencé à travailler à la distillerie en 1977, à l'âge de 17 ans. Au fur et à mesure que la journée avance, il devient clair à quel point ses souvenirs ont été importants pour donner un sens à l'énigme de la façon de recréer le style cireux et fruité idiosyncratique de Brora.
Il est facile de se focaliser sur un seul élément clé du caractère d'une distillerie, oubliant que la distillation est une interaction complexe entre une multitude de composants. Ici, le moût clair issu de la cuve d'empâtage constitue la première étape de la création de l'ADN de Brora. Cela réduit considérablement les notes de noisette du spiritueux. Vient ensuite une fermentation de 115 heures en cuves de fermentation en bois. Conserver le moût fermenté dans ces cuves après la transformation du sucre en alcool stimule la formation de lactobacilles (LAB). En réagissant avec l'acidité plus élevée du moût, ils créent des esters fruités.
Plus la fermentation est longue, plus les choses deviennent fruitées. Stewart et moi sommes passionnés par une étude récente qui montre que chaque distillerie possède sa propre colonie de lactobacilles. « Changer de plante ou trop nettoyer nuit à cette colonie », dit-il. « Il faut des conditions optimales. C'est un système vivant. »
Dans la salle de distillation, nous sommes écrasés par les deux énormes alambics en cuivre terne dont le ventre semble nous clouer au sol tandis qu'ils s'élèvent vers le haut, tels des tuyaux se jetant dans les cuves à vis sans fin. Étant Brora, il y a une autre particularité. « Un lavage nous donne deux passages de lavage, qui donnent ensuite 1,4 passage de spirit still », explique Stewart, ignorant qu'expliquer les mathématiques à une personne dyscalculique est une tâche ardue.
« Une semaine, on fera huit sorties alcoolisées, la semaine suivante, neuf. » Il sourit, lisant mon étonnement, anticipant la question suivante.
« On ne sait pas vraiment ce que ça fait, mais c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, alors on y est totalement dévoués. » Il lève les yeux. Un léger soupir. « Ouais », dit-il, « ce sont de belles photos. »
« J'ai retrouvé un livre de roulement datant de 1966 », raconte Andy. « Il y était écrit que le 11 mars, “le livre des psaumes sacrés a été produit et nous avons chanté tout un tas de psaumes, mais la lessive n'a pas été plus rapide”. Imaginez tous ces ouvriers qui chantent encore des psaumes autour de la lessive. »
Le chant des psaumes pourrait bien être l'ingrédient secret des signatures cireuses de Clynelish et Brora. Pour moi, celle du premier est plus texturée, comme de la cire de bougie, tandis que celle de Brora est plus épaisse mais plus huileuse. Ces deux phénomènes sont censés résulter de l'accumulation d'un dépôt graisseux dans le récepteur des coups de poing et des feintes. Sans cette saleté, la cire disparaît.
« Mais ce n'est pas seulement la crasse », explique Stewart. « Tout se joue avant : un moût clair, une densité plus faible, de longues fermentations. De nombreuses analyses ont été réalisées sur la crasse pour tenter de quantifier son origine et la composition de ses composants, mais il y a tellement de variables. C'est là, pour moi, que l'aspect artistique entre en jeu. »
L'autre point important est le terroir, qui n'est pas défini et qui est une zone vraiment intéressante. Cela renvoie à cette étude du LAB. Il existe un lien absolu entre le lieu, l'eau, l'environnement et ce caractère cireux. Ils ont essayé à Dailuaine, mais sans jamais atteindre la même intensité. Aberfeldy et Craigellachie étaient cireux, mais ils étaient aussi différents.
Je me tourne vers Kevin pour obtenir de l'aide. Il sourit. « Je peux t'expliquer comment ça se passe ? Non, mais je sens un ressac et je te le dis. Ça commence plus tôt que dans la salle des alambics. »
Pour s'assurer que la crasse adhère, ils ont nettoyé l'intérieur des nouveaux réservoirs en acier. On regarde à l'intérieur, et des saletés commencent à se former sur les côtés.
Plus tard, pendant que les autres prennent le thé, Kevin me fait un clin d'œil. « Tu as déjà vu la crasse à Clynelish ? Allez, viens. » Nous gravissons la colline où (avec notre permission et notre détecteur de gaz) nous ouvrons l'un des réservoirs. Il est recouvert d'une épaisse couche gris-noir, douce comme de la soie et d'une beauté étrange.
Nous avons discuté sur le chemin du retour. Qui t'a appris ? « Tous les anciens ici », dit-il en commençant à énumérer les noms : Donald Cameron, Duncan Mathieson, Hoopy le tonnelier. « Ils travaillaient ici depuis toujours, 40, 50 ans. » Il apprenait auprès d'hommes qui travaillaient à Brora depuis la fin des années 1920. Le whisky, c'est la continuité, la transmission du savoir.
Et les méthodes ont changé ? « Stewart a les diplômes. J'ai mon nez et mes yeux. Je peux te cirer, mais je le ferai à ma façon et ce sera différent des autres. Je suis un vrai bricoleur. Je sais si ce n'est pas bien, et ça ne s'acquiert qu'avec le temps. »
Les anciens dont il parlait auraient dit la même chose de leurs ancêtres. Nommer ces personnes est pour moi davantage un lien avec le passé que la magnifique restauration et les salles de réception destinées aux nouveaux clients fortunés de Brora.
De retour à l'intérieur, Andy sort d'autres registres. « À la fin du XIXe siècle, Brora vendait 90 % de sa production à des particuliers », explique-t-il. « Souvenez-vous que le chemin de fer est arrivé ici en 1870. Il a attiré des touristes, permis d'expédier du saumon du jour au lendemain à Londres et facilité la distribution du whisky. La distillerie est indissociable de l'histoire du village, et le village est indissociable de celle de la distillerie. »
Que signifie son retour pour la communauté ?
« C'est immense », dit Kevin. « Énorme. Même quand on l'appelait Clynelish, tout le monde l'appelait “la distillerie de Brora”. Clynelish, c'est incroyable, mais ne pas perdre l'histoire de Brora, c'est merveilleux. »
« Il faut ouvrir les portes et faire entrer les gens », ajoute Stewart. « Organisez des journées communautaires, invitez les anciens, mon père, à partager leurs histoires incroyables. Ils nous ont été d'une grande aide. »
Y avait-il beaucoup de rivalité lorsque les deux distilleries étaient en activité ?
« Les anciens étaient fidèles à ce club », explique Kevin. « Monter sur la colline était perçu comme une promotion, mais ils sont restés. Clynelish était censé être une réplique, mais ils n'ont pas le même esprit. »
Étant donné que vous avez travaillé dans les deux cas, quelles sont les différences ?
« Brora était un meilleur whisky ! »
Nous sommes maintenant dans l'un des anciens entrepôts. Style « dunnage », sol en terre battue, piles de fûts basses. Une odeur d'humidité et des fumées entêtantes. « Le ruisseau coule à côté, voyez-vous », dit Kevin. « Si vous travailliez ici, vous auriez les pieds dans une boue épaisse comme de la mélasse. L'humidité donnait un meilleur whisky. »
Andy sert des échantillons de ce whisky de 39 ans d'âge, exclusif à la distillerie. Il est élégant, fruité, avec des notes d'agrumes, une touche minérale, des fruits à noyau et des notes de banane. On y retrouve cette étrange onctuosité qui rappelle « Brora ».
Brora a été intensément fumé, légèrement tourbé ou non tourbé : variations sur un thème. L'intensité huileuse qu'il a donnée aux assemblages a nécessité son vieillissement en fûts à usages multiples, le chêne n'apportant que peu de saveurs. Après quatre décennies, l'air a pris plus d'influence, les huiles se sont concentrées, les fruits ont dérivé vers les tropiques, l'humidité s'est infiltrée.
Les saveurs et les textures sont poussées au-delà du sûr et du joli dans des domaines qui ne ressemblent en rien à ce que le whisky « devrait » avoir comme goût.
Les limites du langage sont révélées. Que signifient ces listes de mots ? Laissez-vous simplement séduire par la sensation.
À Highland River, Kenn et son ami Beel sont enivrés par une « inexplicable odeur de miel dans l'air capricieux de juin. Ils l'ont eue, puis l'ont perdue… L'odeur était réchauffée par le soleil ; elle possédait un enchevêtrement rare. »
Cet « enchevêtrement » est un aspect du lieu. C'est la magie du verre. Les mots n'ont plus d'importance, les détails techniques s'estompent. Il n'y a que vous, la mémoire et le liquide. La réaction est viscérale. Elle vous tient.
« Restez silencieux et immobile, et observez ce qui se passe », écrivait Gunn dans son essai « The Flash » . « Le véritable intérêt de l'expérience est de se retrouver soi-même… l'expérience est incroyablement rafraîchissante, aussi fraîche que l'air parfumé au bouleau, et pleine d'émerveillement. »
Mais malgré les difficultés du langage, nous essayons toujours de cerner les saveurs, comme le faisait Gunn. « Je ne crois pas que la description du goût d'une Orange Pippin ait jamais été résumée en une phrase », écrit-il dans son autobiographie, L'Atome du Délice , « mais nous avions notre expression pour la noisette… et c'était “goût whisky”. »
« Le craquement… l’empâtage, l’empâtage de l’empâtage jusqu’à ce qu’à l’aide d’un généreux crachat l’ensemble atteigne ce degré de liquidité qui libère pleinement les saveurs ultimes, la quintessence du goût du whisky. »
Il associe également le « goût du whisky » aux neuf noisetiers de la légende celtique, qui entouraient le puits de la connaissance. Lorsque les noix tombèrent dans le bassin, le saumon de la sagesse les mangea. Découvrant le bassin, le héros Fionn MacCaumhaill mangea le saumon, acquérant ainsi la sagesse et la connaissance de la poésie. Le goût du whisky est au cœur de tout cela.
Le goût de Brora évoque tout cela, mais aussi les gens et la transmission, un vieux distillateur apprenant par ses sens, Stewart et son père, et cette idée de continuité. Il y a aussi l'acceptation d'un défi, les sourires de ces vieillards qui disent : « D'accord, essayez de faire comme nous. » Trouver les pièces du puzzle, formuler des hypothèses, tester des théories.
Je repense à Nick Card sur les Orcades. Ici, les pièces sont cachées dans les greniers et les esprits, dans des cuves, des fûts et des verres. Brora est un exercice de mémoire, mais il ne faut pas s'y laisser subjuguer, car on ne peut créer aujourd'hui que ce qu'on crée aujourd'hui.
Lors de l'ouverture, Jim Beveridge, alors maître assembleur de Diageo, a déclaré : « Nous allons recréer le système, tout remettre en place, et ce sera ce que ce sera, et ce sera Brora. » Cela a presque fait pleurer Stewart.
Il y a un sous-texte ici selon lequel, comme pour toutes les distilleries, une fois que les choses sont mises en mouvement, à un moment donné, les saveurs vont se déformer et changer et la distillerie décidera dans quelle configuration elles se situent.
Le Brora que nous pensons connaître n’est qu’un tout petit coin du tableau.
Nous évaluons une distillerie à partir de stocks anciens. Brora reste difficile à cerner, car nous ignorons son goût en tant que spiritueux de nouvelle fabrication, ni en tant que jeune whisky. Il est impossible de produire un whisky de 39 ans d'âge ; on ne peut que le préparer et espérer. « Ce sera Brora » ne signifie pas qu'il sera le même. Il sera ce qu'il deviendra.
Nous logeons dans un Airbnb ce soir-là, dans une rangée de vieilles maisons de cheminots près de Lower Brora. Nous longeons le petit port, construit pour les charbonniers, jusqu'au Sutherland Arms pour un repas, mais nous nous éloignons, incapables de supporter deux couples ivres qui crient à tue-tête à propos d'accouchements problématiques. Heureusement, il y a Sid's Spice, un excellent restaurant de curry (les restes de poulet au tamarin se mariaient bien avec une tranche de poulet et des champignons au petit-déjeuner).
Nous nous servons quelques gorgées de Clynelish. Christina [Kernohan], séduite par l'étrangeté de Brora, avait demandé le prix de départ, mais, sans surprise, avait refusé d'acheter quand Andy lui avait annoncé : 8 500 £.
Que Brora soit actuellement un jouet pour ceux qui peuvent en mettre une caisse dans le coffre de leur Ferrari est inévitable, compte tenu de l'essor du marché du luxe et du faible stock de whiskys matures. Espérons que cela changera d'ici une décennie, lorsque le nouveau whisky sera disponible. En attendant, ces portes sauvages devraient être ouvertes à tous ceux qui souhaitent simplement assister à cette renaissance remarquable et louable. Après tout, c'est « la distillerie Brora ». Elle appartient au peuple.
Un sens du lieu : un voyage autour du whisky écossais par Dave Broom, Mitchell Beazley 2022
* Photo de couverture avec l'aimable autorisation de Christina Kernohan